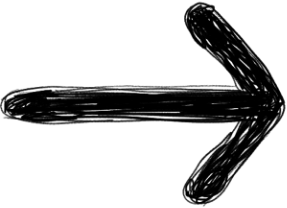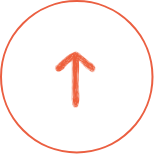Oui, j’ai avorté trois fois (et je vous emmerde)
Chronique résistante
Une chronique de notre journaliste Sarah.
C’est aujourd’hui. La journée internationale de lutte pour le droit à l’avortement. Une journée plus que jamais nécessaire, ces temps-ci, on ne va pas se mentir (coucou les États-Unis et l’Italie, pour ne citer que ces exemples). Si on parle beaucoup de l’IVG (en tous cas, dans nos communautés) en tant que possibilité de choisir, je trouve néanmoins qu’on en parle que très peu intimement. Et il s’avère que c’est presque aujourd’hui, aussi, que je fête l’anniversaire (10 ans, déjà !) de ma première grossesse non-désirée. Depuis ? J’ai avorté deux fois de plus. Et pour bien (et encore mieux) emmerder celleux (enfin surtout ceux) que ça pourrait déranger, j’ai décidé de le crier haut et fort. Mieux encore : de tout vous raconter.
NB : si je suis contre l’argument bien rebattu et très conservateur type “l’IVG c’est traumatisant parce que comment ne pas souffrir en choisissant de ne pas avoir un enfant quand on est une fEmMe”... Je n’ignore pas pour autant qu’entendre parler de ça peut être difficile pour certaines personnes. Bref : avec l’IVG, on peut aller du général (en disant que c’est un choix et un droit qui devrait être inaliénable), au très particulier (aka en partageant des vécus intimes comme le mien). J’espère ainsi que les positions tranchées que j’adopte dans cette chronique ne viendront pas heurter votre propre vécu. Si c’est le cas, n’hésitez pas à respecter vos limites de lecture et à quitter cet article.
30 ans, quatre grossesses, zéro enfant (et tout va bien, merci)
Je pourrais commencer par vous parler de ma première IVG - vous dire que j’avais 20 ans. Puis, vous expliquer que la deuxième fois, c’était 6 ans plus tard - faites le calcul. Et enfin, vous raconter que la dernière fois, c’était en 2021, et que j’en avais presque 29. Je pourrais aussi vous dire qu’entre la deuxième et la troisième fois, je suis tombée enceinte (oui, encore), et que j’ai fait une fausse couche.
Bref, je pourrais vous balancer ce statement, qui ferait bien grincer des dents les réacs : j’ai 30 ans, et je suis tombée enceinte quatre fois. Sans jamais le désirer. Alors, chaque fois, j’ai volontairement interrompu ma grossesse - à l'exception de la fois où mon corps a décidé de le faire pour moi. Voilà le topo : chacun de ces avortements a été ce que la team reac appelle des "avortements de confort".
Je suis tout particulièrement concernée par cette injure, puisque, selon les mots de Marine Le Pen quand elle faisait campagne pour la présidentielle en 2012, un avortement de confort peut se définir, grosso modo, comme le fait d’utiliser l’IVG comme un moyen de contraception. Elle citait, à ce moment-là, le cas des femmes qui ont avorté à répétition, “deux fois ou trois fois”.
Alors aujourd’hui, j’écris pour dire qu’il n’y avait rien de confortable là-dedans. Aucun avortement ne l’est jamais. Mais je vous préviens : il n’y a pas de quoi, en ce qui me concerne, appeler ça un “événement traumatisant” non plus. J’ai fait ce que je devais faire. Ce que je voulais faire. Une bonne manière de vous dire que le plus violent, dans l’histoire, ce n’est pas d’avorter : c’est de le faire dans un monde où on vous pourrit la gueule quand vous le faites. À base de discours culpabilisants, d’anti-douleurs insuffisants, de médicaments pas adaptés, de difficulté d’accès à l’IVG (et je vous en passe).
Je ne manque pas de bonnes raisons d’avorter
J’ai commencé à penser à écrire cette chronique cet été, en lisant l’excellent Avortée, de Pauline Harmange. Elle s’y livre à un exercice difficile - celui de raconter et d’analyser son avortement, comme expérience à la fois intime et politique.
Et il y a ce passage, dans le livre, qui m’a marqué - celui où elle réfléchit sur cet espèce de soulagement qu’elle a ressenti, de faire partie de la team de celles qui ont avorté alors qu’elles étaient contraceptées (elle portait un stérilet quand elle est tombée enceinte).
Elle dit : « Le “j’ai tout bien fait comme il faut, ce qui m’arrive est la faute à pas de chance” qui était ma complainte, il jetait sous le bus toutes celles qui n’auraient pas tout bien fait comme il faut, quoi que ça veuille dire. Il disait en creux que si je n’étais coupable de rien, d’autres femmes pouvaient être coupables de quelque chose, elles. Et que j’étais meilleure qu’elles, les écervelées, les irresponsables, les inconséquentes. »
Puis, elle ajoute : « Au plus difficile de l’épreuve, j’ai été bien soulagée de me rattraper aux branches de ma situation bien sous tous rapports pour alléger la honte de l’avortement. Un sentiment de supériorité bien laid, témoin d’un mépris de classe presque inconscient. »
Évidemment, en disant ça, elle met le doigt sur quelque chose d’important : il y aurait de bonnes et de mauvaises raisons d’avorter.
Avorter : à qui le droit, à qui la faute ?
Tout ça m’a foutu en dissonance cognitive. Car en réfléchissant à l’écriture de cette chronique, j’étais partagée : allais-je être tentée, moi aussi, de me justifier ? D’expliquer que “j’avais tout bien fait comme il faut, mais que merde, ça n’a pas marché” ? Puis je me suis souvenue d’une chose primordiale : mes raisons d’avorter ne regardent que moi. Et comme le dit si justement Pauline Harmange : « Il n’y a pas de bonnes raisons, pas de mauvaises, à part celles qui se chevillent à nos corps pour ne plus nous lâcher, celles qui nous obsèdent et rendent finalement la décision évidente. »
Pourquoi j’ai avorté ? Parce que je l’ai choisi. Parce qu’il le fallait. Parce que je le voulais. Voilà, le constat est fait. Mais j’ai tout de même bien envie de réfléchir à deux-trois coupables. Des coupables qui ne seraient pas moi.
Sur le banc des accusés, j’appelle : les solutions contraceptives proposées (ou imposées), et traitements hormonaux (idem). J’appelle aussi la grande mif des diktats de la société qui pourrissent nos sexualités et notre capacité à connaître nos corps. Et, dans le même cortège, les violences sexistes et sexuelles. Ainsi que les oppresseurs et réactionnaires qui s’arrogent un droit de regard sur nos corps, comme si notre droit à en disposer était un foutu débat.
Petite histoire d’un fail contraceptif
Posons le décor : je suis sans doute en plein dans la tendance de ce que certains médecins analysent comme un recul du recours aux méthodes contraceptives chez les femmes de 20 à 29 ans. Alors bien sûr, c’est vrai qu’on a de la “chance”, en France, de pouvoir “choisir”. D’avoir accès à différentes solutions contraceptives, comme à la possibilité d’avorter (grâce aux conquêtes féministes du siècle précédent, qui sont chaque jour fragilisées et précarisées, ne l’oublions pas).
Mais la contraception, parlons-en. J’ai pris la pilule. J’en ai essayé deux différentes, pendant 5 ans et demi - de mes 15 à mes 20 ans, en continu. On me l’a donnée parce que j’avais des règles extrêmement douloureuses. Seulement, il se trouve que je n’allais pas très bien. J’ai beaucoup déprimé. Beaucoup grossi, aussi - ce qui crée évidemment beaucoup d’emmerdements pour une personne non seulement très anxieuse (pour le dire poliment), mais aussi anorexique-boulimique. Après ça, j’ai aussi essayé l’implant (un échec à base de saignements pendant 6 mois), puis une autre pilule, encore, très récemment. La longue liste des effets secondaires étant ce qu’elle est, aucune de ces solutions n’a été la bonne.
Et puis, pas de chance pour moi : la seule solution contraceptive qui m’intéresse ne m’est pas autorisée. Il s’agit du stérilet au cuivre, un contraceptif mécanique (la seule méthode non-hormonale qui existe, à part les capotes, le diaphragme et la stérilisation), qui est rigoureusement proscrit quand on souffre d’adénomyose et/ou d’endométriose.
Bref : du fait de la pauvreté des solutions contraceptives proposées, j’ai, à de nombreuses reprises dans ma vie, flotté dans des espaces-temps où je n’étais pas contraceptée - comme en ce moment. J’ai cherché, j’ai essayé… Et j’ai aussi souvent lâché l’affaire, honnêtement.
Je me suis, bien des fois, comportée de manière “imprudente”, comme certains aiment à le dire. Et j’ai eu, à chaque IVG, la drôle d’impression d’être (sévèrement) punie. Comme si le fait de vivre ma sexualité comme je la vi(vai)s, avait un prix. Un prix à payer en colère, en douleur, ou en honte.
Balek versus charge sexuelle
Je récapitule ? En ce qui me concerne, j’ai l’impression de me retrouver face à des choix bien relous, quoiqu’il.
Choix numéro 1 ? En cohérence avec cette culture sociétale qui déresponsabilise les hommes pour faire peser la charge sexuelle sur les épaules des femmes, je prends les choses en charge côté contraception (car je sais que si ça merde, c’est à moi que ça va coûter cher et chair).
Choix numéro 2 : en cohérence avec la pauvreté de mon éducation sexuelle (et en roue libre dans mon numéro de performeuse du cul), je priorise les désirs de mon / mes partenaires cis-het sur les miens, m’oublie complètement, et me retrouve constamment dans des situations où j’ai des rapports à risque côté contraceptif.
Un partout, balle au centre : je me dis aujourd’hui que j’ai peut-être choisi, par défaut, de ne pas (suffisamment) prendre sur mes épaules la charge sexuelle que j’aurais dû porter. Même si j’ai essayé, comme je vous l’ai raconté. Mais j’ai aussi, quelque part, et à certains moments, complètement abandonné. Mais voilà : quatre grossesses non-désirées plus tard, je me dis… Et maintenant, je fais quoi ?
Franchement, je ne sais toujours pas. J’ai quand même pris RDV pour me faire poser un stérilet hormonal, dans un mois. Pas tant par conviction que par nécessité : mon endométriose me l’impose. Me rappelant au passage que ma vie gynéco ressemble fort à un jeu style “tu préfères” version “le truc claqué au sol ou le truc encore plus claqué au sol”. Le patriarcat a vraiment le sens de la générosité.
Pas merci les réacs
Maintenant que le décor est posé, j’aimerais terminer là-dessus : une petite lettre en forme de doigt d’honneur à ceux qui pensent avoir leur mot à dire sur l’IVG. À ceux qui pensent avoir un droit de regard sur nos culs, nox choix, nos sexualités.
Un exemple ? Il y a quelques temps, je trainais sur Insta et je suis tombée sur ce commentaire d’un merdeux reac qui disait un truc du genre « J’ai pas envie que mes impôts servent à payer les avortements de confort de ces salopes ».
Bon. Au-delà de faire de cette personne un gros connard de droite qui n’a rien compris à la nécessité de la sécurité sociale… Eh bien, disons que ça m’a trigger. Parce que j’ai ressenti cette fameuse culpabilité qu’on me met constamment sur les épaules depuis mon premier IVG. Le poids du “peut mieux faire”. Du “salope”. Ou du “t’exagères”.
Puis, très vite, ça m'est revenu en pleine gueule : la colère. Et puis des faits. Des chiffres. Sur ce que la violence des hommes cis coûte à la société. 100 milliards d’euros par an, selon l’historienne et écrivaine Lucile Peytavin. Alors de qui se moque-t-on ?
Qu’ils nous laissent avorter en paix. Qu’ils nous laissent être maman solo, être enceint ou enceinte ou enceint·e. Qu’ils nous laissent changer d’avis 3 fois sur notre désir d’enfant ou pas. Qu’ils nous laissent dire qu’on n’en veut pas et qu’on préférerait accoucher d’un projet, d’un disque ou d’un livre. Qu’ils nous laissent nous ligaturer les trompes, faire une FIV ou avoir accès à la GPA.
Et pendant ce temps-là, qu’ils s’occupent donc de soigner leur psychose patriarcale : voilà ce que j’ai envie de leur dire.
Alors, je le répète : j’ai avorté. Trois fois.
Et si je devais le refaire, je le referai. Et que cElleUX que ça dérange osent, ne serait-ce que pour une journée, vivre des règles sous endométriose. Vivre avec le poids de la honte, du trauma, ou juste sous le poids de leurs violences qu’ils accumulent en totem sur nos épaules qui bleuissent.
Qu’ils viennent se taper une dépression aggravée par la prise d’un traitement contraceptif. Qu’ils viennent s’enquiller des problèmes veineux aux jambes qui vous empêchent de marcher ou de dormir. Qu’ils viennent pisser du sang pendant 6 mois chaque jour à la suite de la pose d’un implant. Qu’ils viennent se retrouver à perdre 10 kilos et à en reprendre 15 à chaque changement de contraception, le tout, sponsorisé par des gros TCA. Qu’ils viennent se taper un avortement médicamenteux avec une tumeur dans le myomètre, où chaque contraction ressemble à une copie de la mort en HD. Qu’ils viennent un peu s’asseoir à la table et discuter de ce qu’il faut faire pour nos sexualités et nos rapports qui sont à réinventer.
Qu’ils viennent me chercher. Je ne me cacherai pas. Et je le répéterai autant qu’il le faudra. J’ai avorté trois fois, et je les emmerde.