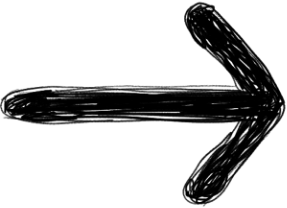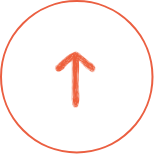La série Unorthodox nous a appris 5 choses essentielles
Netflix & Learn
Elle a commencé par une petite fame silencieuse, avant d’enflammer nos apéros Zoom : Unorthodox est la série pépite qu’on n’attendait pas vraiment sur Netflix et qui nous a cueillies pour plein de raisons. Elle raconte l’émancipation d’Esty, une jeune femme appartenant à une communauté juive ultra orthodoxe de Brooklyn qui s’enfuit à Berlin pour vivre sa propre définition de la liberté. Directement inspirée de la vie de Deborah Feldman, cette série initiatique nous a fait un bon gros choc.
Attention, cet article contient des spoilers, si vous n’avez pas encore vu Unorthodox, c’est par ici.
On est la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour nous
C’est peut-être la leçon la plus directe qu’on ait retenue de cette série. On peut avoir l’impression, à force d’entendre les mêmes discours, que nos parents, nos potes, nos profs savent mieux que nous ce qui nous rendra heureuse, qu’iels “nous connaissent mieux que nous-même”, et que sans leurs conseils on répétera les mêmes erreurs et bad choices en terme de carrière, d’alimentation ou de partenaire #cegaçonnestpasbonpourtoi.
Sauf que la personne la mieux placée pour faire des choix concernant notre vie, ben c’est nous en fait. Surtout que les conseils des autres se construisent souvent inconsciemment sur des clichés sexistes, racistes et homophobes : au hasard, quand vous rêvez de devenir astrophysicienne et qu’on vous dit qu’assistante maternelle vous irait tellement mieux #faitnousconfiance.
Dans Unorthodox, tout est imposé à Esty, par son entourage, et par les règles de sa communauté : ses vêtements, sa coupe de cheveux, son mari, quand elle peut ou non dormir avec lui, ses passions et occupations (quelle femme a besoin de jouer au piano quand son unique but doit être de tomber enceinte ?).
Pour nous, les deux plus beaux moments de la série sont le “baptême” d’Esty dans le lac à Berlin, et son audition. Dans le lac, elle renaît en se débarrassant du symbole de son oppression, sa perruque, et en se mettant en quelque sorte à nu ; et sur scène, elle peut enfin faire entendre sa voix et devenir pleinement elle-même. Même quand Yaël lui dit qu’elle ne fera jamais carrière dans la musique après l’avoir entendue au piano, elle n’abandonne pas et prouve que la musique fait intrinsèquement partie d’elle. Be Esty.
Il y a parfois 2 versions d’une même histoire
Une autre intrigue secondaire nous a particulièrement touchée dans Unorthodox : les rapports complexes entre Esty et sa mère, qui a quitté la communauté 15 ans auparavant. La version qu’Esty connaît, c’est que sa mère l’aurait tout simplement abandonnée, ainsi que son père, pour construire sa vie en Allemagne. Sauf que… quand elles se retrouvent seules pour la première fois en 15 ans, sa mère peut enfin lui raconter qu’elle a fuit son mari avec elle, et qu’elles ont vécu quelques temps dans un appartement avant qu’Esty ne lui soit arrachée par l’armée d’avocat·e·s des Satmars.
Une histoire, deux versions. Esty pensait avoir la bonne et se rend compte que ce n’est pas le cas. À garder dans un coin de notre tête pour la prochaine dispute entre potes, querelle familiale ou quiproquo au taf.
Il y aura toujours des gens pour nous aider
Si Esty parvient à s’enfuir à Berlin et à y démarrer une nouvelle vie, c’est grâce à sa prof de piano, qui l’aide à faire ses papiers et prendre son billet d’avion, aux étudiants de l’école de musique qui l’accueillent, à sa mère qui la protège… Parce qu’il aura toujours des personnes bienveillantes autour de nous prêtes à nous porter secours qu’importe la situation, et parce qu’il ne faut pas hésiter à demander de l’aide quand on en a besoin.
Esty demande de l’aide à sa prof de piano, puis demande si elle peut accompagner le groupe d’étudiant·e·s au lac, ensuite si quelqu’un peut l’accompagner au piano et l’aider à s’entraîner pour son audition, et va chez sa mère pour avoir un endroit où dormir.
Ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups, on le voit quand sa grand-mère lui raccroche au nez. Mais ça dit 3 choses importantes :
1/ qu'il faut accepter de demander de l'aide pour en recevoir
2/ que l'aide ne vient pas forcément d'où on l'attend (inconnu·e·s versus la grand-mère d'Esty), et qu'il faut du coup être bienveillant·e et soucieux·se des autres au quotidien, car elles et eux aussi pourraient avoir besoin de notre aide, et on ne sait jamais, notre concierge pourrait un jour nous sauver la vie #karma.
3/ qu'il ne faut surtout pas écouter les personnes qui vous disent que vous êtes seule, que vous ne pouvez compter sur personne et que sans aide vous êtes foutue, parce que c’est faux. Même si votre famille vous tourne le dos, vous ne serez jamais seul·e·s, il y a des gens pour vous partout (et ici aussi d'ailleurs).
L’ouverture d’esprit est contagieuse
Autre note d’espoir que nous donne la série, quand Yanky, le mari d’Esty, la retrouve à Berlin : après avoir essayé de la ramener près de lui, il comprend que c’est à lui de se rapprocher d’elle, et décide par exemple de couper ses boucles de la même façon qu’Esty a retiré sa perruque.
Interrogée par Madame Figaro, la rabbin Floriane Chinsky donne cette très belle image : « Dans la série, il y a comme une chaîne d’oppression qui part du rabbin vers les hommes et les femmes, les femmes vis-à-vis de leurs fils, les fils vis-à-vis de leurs épouses, etc. Et une chaîne inversée, de retrouvailles de la liberté, qui part de Esty, remonte vers son mari… et pourra peut-être aller plus loin ».
Ce à quoi elle rajoute, à propos de Yanky toujours : « Il s’affranchit de manière assez remarquable : quand il se retrouve auprès d’une prostituée, il ne rentre pas dans un schéma sexuel oppressif mais lui parle, lui demande comment donner du plaisir à sa femme. Les choses bougent ».
L’élan libertaire d’Esty fait des émules dans la communauté Satmar et ouvre aussi la porte à une réflexion sur les règles sociales et le libre arbitre de chacun·e. C’est parfois en montrant l’exemple, en montrant que des changements sont possibles, que d’autres peuvent à leur tour ouvrir les yeux. Et c’est tout ce qu’espère Deborah Feldman.
Bonus : C’est quoi exactement le vaginisme ?
Dans la série, Esty découvre les rapports sexuels avec son mari dans la douleur. La pénétration est impossible, et toute autre pratique inconnue des deux jeunes marié·e·s. C’est la “conseillère sexuelle” qui lui apprendra, sans vraiment lui expliquer ce que c’est, qu’elle souffre de vaginisme.
Si on l’avait déjà entreaperçu dans la série Sex Education avec le personnage de Lily, Esty nous permet de nous replonger un peu plus dans la compréhension de ce mal qui touche environ 350 000 femmes en France.
Le vaginisme n’est pas une maladie physique ou une malformation, c’est une angoisse liée à la pénétration qui entraîne une contraction réflexe des muscles du périnée, rendant ainsi impossible toute pénétration - ou même l’introduction d’un tampon - sans causer de fortes douleurs. C’est donc un blocage psychologique, souvent dû à un traumatisme, ou à une éducation cerclée de tabous sur la sexualité, comme celle d’Esty au sein de la communauté Satmar.
Dans une interview pour le Figaro Santé, la Dr. Véronique Bonniaud, responsable de l’unité pelvi-périnéologie du CHU de Dijon explique que la première étape pour soigner le vaginisme est « *la réappropriation de cette zone intime pour ne plus en faire un tabou* »**.
D’abord par la théorie : guidées par un·e kinésithérapeute spécialisé·e, les femmes apprennent l’anatomie du sexe féminin, puis découvre le leur à l’aide d’un miroir. Vient ensuite la pratique : le ou la kiné leur enseigne des exo de relaxation du périnée et leur donne des conseils pour explorer leur corps.
« Une fois qu’elles ont réussi à se toucher, on peut leur proposer d’utiliser des dilatateurs vaginaux, des dispositifs médicaux en forme de tampon. L’objectif n’est pas de dilater le vagin, mais de montrer aux patientes qu’il peut accueillir le pénis d’un homme sans provoquer de douleurs », explique la spécialiste. Si jamais ces symptômes vous parlent, sachez que vous pouvez en parler avec votre gynéco.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les communautés juives ultra-orthodoxes, on vous conseille aussi ce docu sur Netflix.