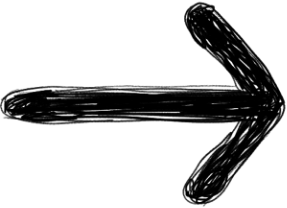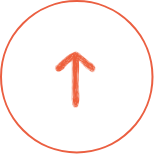La série Russian Doll nous a appris 3 choses très importantes
Netflix & Philo
Il faut savoir qu’à la base, on ne voulait pas regarder Russian Doll (ou Poupée Russe, en français). À cause notamment de ce qui avait l’air d’être un scénario de blockbuster à la c** : soit un personnage qui n’arrive pas à mourir et qui revit éternellement la même journée (#unjoursansfin). Spoiler : on avait parfaitement tort. Cette petite pépite de série pop et philo co-réalisée par 3 femmes est devenue notre doudou (chelou) à binge watcher dans les moments où la vie n’a plus de sens. On vous raconte ?
Le pitch (sans spoilers) : dans Russian Doll, Nadia (le personnage principal, brillamment interprété par Natasha Lyonne) revit à chaque épisode et inlassablement la soirée d’anniversaire de ses 36 ans. Pourquoi ? Parce que chaque soir elle meurt (dans des circonstances souvent chelou), pour finir par réapparaitre face au miroir des chiottes de sa BFF, Maxine, qui organise une soirée en son honneur dans son giga-appart. Métaphysique, ha ? La bande-annonce, par ici.
La dépression est une poupée russe
Ce qu’on adore dans cette série, c’est qu’elle a l’audace de nous montrer un personnage féminin qui resplendit de son imperfection : grande gueule, souvent injuste, parfois paranoïaque (oups), addict à l’alcool (entre autres) et littéralement dépressive, Nadia ne cherche pas à être un role model : elle se débat assez avec ses névroses, angoisses, et le monde extérieur pour en avoir quelque chose à faire.

Du premier épisode au dernier, le décor de la série est quasi-tout le temps le même, mais évolue progressivement. Les miroirs, les bruits, et les gens disparaissent : Nadia revit perpétuellement la même nuit et le même lendemain (#gueuledebois), mais elle s’y sent de plus en plus seule. C’est l’idée de la poupée russe (la fameuse matriochka) : chaque structure est similaire mais plus petite que la précédente = la réalité se rétrécit.
Un bon portrait de la dépression, en somme : chaque jour ressemble au précédent, chaque fois que Nadia recommence une journée, c’est la même musique qui démarre (#épuisement) ; soit un fckn looping infernal dont personne n’a les clés ou le bouton off (#lavie). Pour d’autres, le schéma de la série décrirait parfaitement les mécanismes de l’addiction : un retour à la case départ perpétuel, entre jouissance et auto-destruction.

À mi-chemin entre le réel et le (mauvais) rêve, la série met un bon coup de pied dans ce dicton (qu’on déteste) aka “ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort”. En voyant Nadia empiler les morts tragiques et se relever en mode balek, on se dit que ce n’est pas forcément vrai : parfois, ça nous tue à petit feu, et c’est tout. Et le réaliser peut être le step numéro 1 pour sortir de la boucle infernale et demander de l’aide.
Category is : thérapie, entraide et solidarité
Ce qu’on comprend assez rapidement, c’est que Nadia doit donc “dealer avec ses traumas” pour pouvoir continuer à vivre (ou arrêter de mourir) et se sortir de la “poupée russe”. C’est le personnage de sa tante, une psy, qui va pouvoir l’aider à affronter les choses qui la tourmentent (= sa relation avec sa mère qui a des troubles psychiatriques, jouée par Chloë Sevigny).

MAIS PAS QUE. Pour mieux mettre en exergue la question de la santé mentale, Russian Doll envoie Nadia à la rencontre de son opposé : un personnage masculin (aka Alan) bourré de TOC (Troubles Obsessionnels Compulsifs), lui aussi noyé dans la dépression, et dont on apprend qu’il revit à chaque épisode (avant de mourir, sinon c’pas drôle) la nuit où il se fait larguer par sa meuf.
Si ces deux personnages n’ont a priori rien de commun, leurs trajectoires partagées et leurs souffrances posent la question de l’entraide et de la solidarité. Parce que leurs différences et névroses les divisent et les insupportent l’un·e-l’autre, autant qu’elles leur permettent de faire équipe. Et que si, dans un premier temps, ielles se rejettent mutuellement, ce n’est que pour réaliser plus rapidement qu’ensemble la (sur)vie sera plus facile.

Et c’est là toute la beauté de Poupée Russe : nous montrer les affres, déglingues, envolées, dérapées et trajectoires croisées de la maladie mentale, qui se vit souvent seul·e mais à laquelle on peut survivre avec une bonne dose d’introspection (#thérapie), d’humour, d’auto-dérision (#répartie), ET d’amour (#allié·es).
L’amour n’est pas (forcément) la solution
Et encore moins dans Poupée Russe. C’est d’ailleurs un des trucs qui fait qu’on adore cette série : parce qu’elle ne se vautre pas dans l’écueil de nous faire croire que ses deux personnages principaux vont se sauver l’un·e-l’autre sur l’autel de l’amour éternel (poke Hollywood). Dès le départ, on le voit : Nadia et Alan sont deux êtres radicalement différents. Mais ielles partagent (en gros) un secret : celui d’avoir des traumas, des défaillances, et une solitude qui les ronge et dont personne n’a aucune idée.

Quand à la fin de la série, on voit ces deux personnages repartir ensemble, on sait que ce n’est pas pour parler mariage ou être happily ever after. En se choisissant l’un·e-l’autre (versus le plan cul odieux de Nadia), ielles ont fait le choix de privilégier leur bien-être avant celui des autres.
Qu’importe que cela ne ressemble pas à une histoire d’amour ou de sexe bien ficelée.
Ce sont simplement deux personnes qui se connaissent, se reconnaissent et s’apprécient et qui n’ont pas besoin de s’aimer démesurément pour se respecter et décider d’affronter la vie ensemble <3.
Russian Doll (Poupée Russe en français), saison 1, co-réalisée par Leslye Headland, Amy Poehler et Natasha Lyonne, à découvrir au plus vite sur Netflix. La saison 2 devrait débarquer dans l’année !