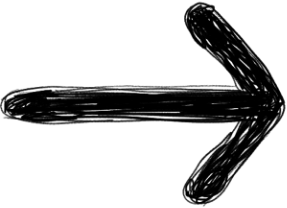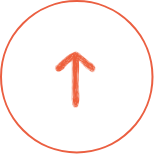4 bonnes raisons de dévorer Féminismes & Pop Culture sans traîner
Masterclass du binge intelligent avec Jennifer Padjemi
Un pied dans la socio, et l’autre dans la pop-culture : l’autrice et journaliste Jennifer Padjemi nage entre deux mondes, et n’a pas peur de faire matcher des quotes de Bourdieu avec une fine analyse de la série Grey’s Anatomy. Et c’est précisément pour ça qu’on l’adore et qu’on a dévoré son livre : accessible, argumenté, augmenté de ses expériences perso et pop-culturées à tous les coins de pages, il raconte à quel point nos séries préférées et les œuvres de la culture populaire sont le lieu de mille possibilités / batailles / contradictions politiques. On vous donne 4 bonnes raisons de dévorer cet essai sans traîner #teamgroupieenmodeteasing.
#1 Parce que la pop culture aide à comprendre la vie
C’est un discours qu’on entend souvent en ce moment : Netflix serait l’équivalent de la porte des enfers, contribuant inévitablement à la mort d’autres cultures, comme celle du cinéma français. Bon. Un peu radical quand même, non ?
Pour Jennifer Padjemi, il y a une forme de classisme (aka une discrimination fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance à une classe sociale, souvent basée sur des critères économiques) inhérente au fait de regarder de haut les cultures pop, comme si elles allaient mettre en danger les cultures considérées comme “plus nobles”. Comment vous dire pourtant qu’une série bingeable est clairement plus à même de toucher le plus grand nombre qu’un essai publié aux Presses Universitaires de France ?
En ce sens, la pop-culture et ses multiples œuvres florissantes peuvent se présenter comme une manière d’ouvrir et d’offrir la culture à toustes, en démocratisant au passage de grands enjeux sociétaux et politiques.
C’est votre pote un peu duper sur la lutte antiraciste qui a beaucoup mieux pigé ses ressorts en regardant Dear White People. C’est votre nièce qui a capté à 15 ans ce qu’était le consentement en regardant Sex Education. C’est vous, c’est nous, qui, sous l’impulsion de la badasserie assumée de Rihanna et de son Bitch Better Have My Money, avons réalisé plus ou moins directement du haut de nos 17 piges que c’était OK de parler d’argent pour les femmes (et d’en vouloir plus).
Pour l’autrice, la pop-culture a la capacité d’être ce portail quasi-merveilleux ouvrant sur une meilleure appréhension et compréhension du monde. Bref : très loin d’une junk food intellectuelle, la culture populaire porte en son sein mille possibilités créatrices, émancipatrices et révolutionnaires… pour peu qu’elle soit capable de se hisser à la hauteur des enjeux de représentation de nos sociétés (coucou les séries quasi-100% blanches et hétéro des 90’s et des années 2000), et qu’elle évite l’écueil de l’instrumentalisation et de la récupération des luttes politiques (coucou les séries qui prétendent faire preuve de diversité en mettant un personnage à la fois racisé, gay et précaire en mode quota).
Une bonne chose à noter dans tous les cas : tout comme la pop-culture, nos modes d’engagement sont multiples et protéiformes. C’est donc tout aussi légitime d’avoir commencé à faire ses armes féministes sur Netflix et Insta que sur les bancs de la fac en Gender Studies.
#2 Parce que la représentativité compte
La culture pop dans les années 90 en France ? Il n’y avait majoritairement aucune place pour les personnes noires, racisées, ou LGBTQI+ - ou même pour un personnage ouvertement féministe.
Mais inutile de s’enflammer trop non plus en pensant que les choses ont changé : l’entre-soi blanc du cinéma français dénoncé par Aïssa Maïga aux Césars 2020 est toujours bien réel.
D’ailleurs, la plupart des productions mettant en scène des personnages racisés ou issus de minorités sexuelles visibles aujourd’hui nous viennent des États-Unis. En France ? On traîne la patte. Et on aime bien (beaucoup) se mettre la tête dans le sable. Pourtant, la question de la représentativité est plus qu’importante pour que la pop-culture ait un vrai impact sur nos vies.
Grandir dans un contexte culturel où aucun·e héro·ïne ou personnage de fiction ne nous ressemble, c’est en quelque sorte être amené·e à accepter sa propre invisibilité. Sur les couvertures des magazines. Dans les hémicycles de pouvoir. Comme l’explique très bien l’autrice “l’estime qu’on a de nous, mais aussi des autres, commence dès le plus jeune âge, par les représentations et figures qui nous sont proposées.” C’est par exemple, ce que l’on a pu observer avec L’effet Scully : ou comment l’existence d’un personnage de femme dîplomée en médecine et en physique dans une série mainstream a poussé dans son sillage de très nombreuses femmes a choisir une carrière scientifique.
Pour Jennifer Padjemi, c’est la réalisatrice Shonda Rhimes qui se présente comme une pionnière sur ce plan : même si elle est loin d’être la première à avoir développé dans ses créations des personnages de femmes noires non-stéréotypés, elle s’est imposée sur une chaîne grand public avec sa série Grey’s Anatomy - qui met notamment en scène le personnage du Dr Miranda Bailey. Elle est chirurgienne, talentueuse, intelligente, directive, mais aussi sensible et geek, bref : c’est un personnage exempt de tout stéréotype, et dont le parcours montre par exemple en filigrane l’isolement des femmes noires dans le milieu professionnel.
Si ce personnage a révolutionné la vie de bien des personnes, c’est parce qu’il est sincère : sans clichés, sans amalgames, avec une personnalité complexe - et pris au cœur d’une vie parcourue par des enjeux aussi intimes que politiques.
Ces créations, comme le rappelle l’autrice au sujet de la série de Michaela Coel, I May Destroy You (dont le casting est essentiellement composé de personnes noires), permettent de “normalise[r] ces vécus et ces expériences, qui n’ont jamais été racontés de la sorte sous prétexte qu’ils n’étaient pas assez “universels””.
En d’autres mots, dans la pop-culture comme ailleurs, le blanc a trop souvent fait figure de “neutre” - ce qu’il n’est évidemment pas. C’est en diversifiant les productions, en visibilisant les vécus de chacun·e, et en ouvrant les canaux de production et de diffusion à des personnes qui n’ont habituellement pas voix au chapitre que l’on peut faire de la pop-culture un espace où la représentativité est vraiment prise en compte.
#3 Pour comprendre qu'il n'y a pas de "mauvaises féministes"
Elle n’est pas parfaite, la pop-culture. Un peu comme nous et notre féminisme, en fait. Elle est multiple, au mieux intersectionnelle, au pire excluante et opportuniste (coucou le T-Shirt Dior “We Should All Be Feminists” à 620 balles, par exemple). Mais ce qui est sûr, c’est que sa manière de se rendre accessible à toustes a contribué à ouvrir le débat sur les formes plurielles que peuvent prendre les féminismes et nos luttes.
Ce qui n’est pas (du tout) du goût de tout le monde : depuis l’émergence de figures comme Beyoncé ou Nicki Minaj, qui revendiquent ouvertement leur féminisme, une frange de la population (pour ne pas dire les féministes blanches et bourgeoises) semble s’être octroyé le droit de décréter ce qui est du féminisme et ce qui n’en est pas.
Comme l’explique l’autrice au sujet de Beyoncé, les arguments pleuvent depuis toujours pour décrédibiliser son engagement politique : “Féministe ? Trop sexy pour l’être et trop amoureuse de son trompeur de mari. Antiraciste ? Récupération politique, pas assez noire pour l’être vraiment. Elle reçoit des critiques sur son corps, son attitude, sa féminité et même sa grossesse, apposées à son “prétendu féminisme”, de la part notamment de journalistes féministes blanches.”
Il y aurait donc un féminisme légitime et un féminisme pop à tej pour son manque de sérieux ? Merci mais non merci. Pour celleux qui consomment de la pop-culture, grandir avec une série inclusive comme Grey’s Anatomy a tout autant son rôle à jouer que de lire le Deuxième Sexe.
Et avouons-le : l’une est quand même beaucoup plus contemporaine et accessible que l’autre. La pop-culture a fait beaucoup pour que le féminisme appartienne à toustes. Elle est ambivalente, un peu comme le raconte l’essai Bad Feminist de Roxane Gay : imparfaite, mais aussi souvent de bonne volonté. Et avec tout ce des figures comme Beyoncé ou Rihanna ont apporté à nos luttes et à nos vies, ce serait pire que dommage de regarder leurs engagements avec mépris.
#4 Parce que cet essai est passionnant et nécessaire
On vit une époque assez cool et unique, quand même : jamais dans toute l’histoire nous n’avons eu accès à autant de films, de séries, de plateformes de streaming aux créations nouvelles qui rejoignent sans cesse les bancs de nos nouvelles séries pref’. Nous sommes bel et bien dans ce qu’on appelle la “Peak TV”.
Comme l’explique l’autrice, ce terme inventé en 2015 par le président de la chaîne FX, habille d’un concept une réalité chiffrée : cette année-là, pas moins de 400 nouveaux programmes ont été diffusés - un chiffre qui n’a jamais cessé d’augmenter depuis. Et parce que les créations se multiplient, elles deviennent aussi plus variées : la diversité des contenus permet donc une plus grande représentativité… mais aussi d’éventuelles récupérations politiques.
Mais quoiqu’il en soit, la pop-culture reste une porte ouverte sur la connaissance du monde - dans sa diversité - mais aussi de soi. L’autrice nous explique d’ailleurs comment elle a largement contribué à amener le sujet de la santé mentale au cœur du débat public.
Ou comment le visionnage d’un épisode d’Insecure de Issa Rae lui a permis de pousser pour la première fois la porte d’un cabinet de psy. Mais aussi comment la série Girls a participé à son éveil féministe. Ou encore comment des séries comme Euphoria, Pose ou Sense8 ont contribué à propulser sur le devant de la scène des questions politiques et intimes liées aux communautés LGBTQI.
Bref : la pop-culture est une marmite à contrastes. Elle permet tout aussi bien de visibiliser des enjeux de société que de les questionner. Elle se vautre parfois dans la récupération, nous invitant à rester attentif·ves à l’instrumentalisation de nos luttes. Mais elle ne manque jamais de se réinventer, de nous faire réfléchir et de se rendre toujours plus accessible.
Sur ces bonnes paroles, on est loin (très très loin) d’avoir abordé l’ensemble des sujets et pistes de réflexion passionnantes que ce livre peut vous offrir, donc un seul conseil : lisez-le. Seul risque ? Vous donner envie de vous faire toutes les séries préf de l’autrice, égrenées au fil des chapitres du livre. Y a pire, quand même :)
Féminismes & Pop Culture, un essai (génial) de Jennifer Padjemi, à découvrir aux éditions Stock, 337 pages, 20,50€. Chopez-le ici.